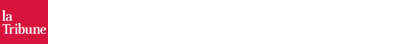Le dilemme des toughs
OUELLET ANTHONY
SHERBROOKE — Malgré tous les messages envoyés à la population par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et les mesures d’atténuation prises à l’interne, les employés des unités d’urgence de la région continuent de faire les frais du surachalandage dans ce secteur. Ceux-ci deviennent donc rapidement pris entre l’arbre et l’écorce à devoir exercer un métier qui les passionne, mais qui est physiquement et mentalement éreintant.
« C’est un milieu qui est difficile... L’urgence, c’est vraiment une zone tampon [...], mais, dans le contexte actuel, la zone tampon s’élargit et éventuellement on nous en demande toujours plus », constate Bianca Richard, infirmière clinicienne à l’urgence de l’Hôpital Fleurimont depuis cinq ans.
La grande majorité des membres du personnel présents lors du passage de La Tribune, lundi soir, à l’urgence du CHUS — Fleurimont n’a pas souhaité s’exprimer ouvertement au micro.
Pour Mme Richard et sa collègue Joëlle Morneau cependant, il était important de prendre quelques minutes pour dresser un portrait fidèle de leur quotidien comme employées de cette unité. « J’adore l’urgence, c’est un milieu vraiment extraordinaire, mais la pression qui pèse sur nous, celle de toujours être prises entre la population et le réseau, c’est difficile à vivre au final. [...] Si je suis capable, je vais tougher le plus longtemps possible, parce que j’adore le milieu », expose Bianca Richard.
« Je me vois longtemps à l’urgence, renchérit Joëlle Morneau, mais c’est sûr qu’en même temps ça devient difficile sur le corps. Je suis encore jeune, c’est correct [rires]. On ne peut pas ralentir le débit non plus, car on ne peut pas refuser des gens, même s’il manque de personnel, même s’il manque de civières. »
Les deux collègues, pour qui l’urgence demeure un lieu de travail enrichissant et stimulant malgré tout, ne cachent pas les heures supplémentaires, notamment le fameux temps supplémentaire obligatoire (TSO), peuvent peser lourd sur les épaules des infirmières.
« Je suis restée la nuit dernière en temps supplémentaire et, pour être 100 % honnête, il y a des besoins ce soir et toute la semaine. On cherche des solutions en analysant les conditions et en regardant qui veut rester. On essaie de se mobiliser entre nous, mais ça peut être un défi de combler les quarts, car personne ne souhaite ajouter un autre quart après sa soirée de travail. On tente toutefois de dialoguer entre nous pour trouver des solutions : par exemple hier j’ai fait quatre heures de plus et ma collègue est venue travailler quatre heures plus tôt », indique Mme Richard.
Mais au-delà du stress physique que peut faire vivre le travail à l’urgence, la perte de connexion avec les patients, due à un rythme de travail trop intense, peut aussi jouer sur le moral des troupes.
« Parfois je reviens chez moi et je me rends compte que tout ce que j’ai fait, c’est être une machine à donner des pilules », laisse tomber une infirmière en temps supplémentaire, qui préfère ne pas être nommée, pour qui le fait de parler avec ses patients est une partie de son travail à laquelle elle s’astreint.
« Oui c’est vrai que c’est vraiment plus valorisant de prendre le temps de t’asseoir avec ton patient, de jaser un peu avec. On a de la difficulté à le faire en raison du roulement et du nombre de patients qui arrivent », analyse pour sa part Bianca Richard.
Les deux infirmières le reconnaissent : le commun des mortels attend, attend et attend toujours plus longtemps lorsqu’il se présente à l’urgence.
ACTUALITÉS DE LA SEMAINE
fr-ca
2023-02-04T08:00:00.0000000Z
2023-02-04T08:00:00.0000000Z
https://latribune.pressreader.com/article/281762748406838
Groupe Capitales Media